Economie et méthodologie (1/2)
Il convient de prendre pleinement en compte la tension qui est partie intégrante de l’économie et du travail de l’économiste. Parce que son objet est un lieu de décisions, privées et publiques, l’économiste est convoqué régulièrement par le Prince (guerrier ou marchand), pour donner son avis, prodiguer ses conseils. ce faisant, il accepte d’interférer avec ce qu’il observe. En même temps, il est convoqué au nom d’une légitimité de type scientifique qui implique, au moins implicitement, une position d’extériorité. Cette tension peut s’exprimer sous des formes diverses; elle induit un débat sur la nature de l’économie en tant que discipline scientifique[1], débat qui ne fait que souligner le besoin de références méthodologiques cohérentes. Avant de pouvoir proclamer des résultats, il faudrait que la méthode soit, si ce n’est irréprochable, du moins consciente de ses limites propres. Autant le dire, ce n’est que rarement le cas, en dépit d’un virulent débat sur la méthodologie économique qui se développe depuis le début des années quatre-vingt, et dont la présente réflexion est largement tributaire[2].
Ainsi, dans le cas français, a-t-on justifié le franc fort au début des années quatre-vingt au nom de l’inefficacité des dévaluations compétitives, puis, au début des années quatre-vingt-dix au nom de la réalisation de l’Union Monétaire, censée nous protéger contre ces mêmes dévaluations compétitives (qui avaient été un succès dans les années 1990 en Italie, en Espagne et en Grande Bretagne…). Faute d’être rigoureux dans sa méthodologie, l’économiste se condamne à être un justificateur et non un analyste, et l’économie entre en décadence.
Il faut donc revenir sur cette question fondamentale: sommes nous à même de penser l’économie d’emblée comme un système décentralisé ou continuons-nous de raisonner, inconsciemment, dans un cadre qui est en réalité celui d’une planification générale. Quelles sont les implications d’une démarche qui considère la socialisation, ou la globalisation, des activités initiées séparément, comme un résultat ex-post et non comme une donnée ex-ante. Comment, dans ce cadre, traiter de l’articulation entre l’individuel et le collectif, intégrer le temps, dans sa durée comme dans son irréversibilité, et faire sa place à la notion d’incertitude et donc de crise. Tenter de penser l’économie décentralisée, c’est faire un long voyage parmi des débats essentiels, mais souvent ignorés.
1/ Pourquoi l’économie décentralisée?
L’heure est donc venue de se pencher sur le cœur du problème: que signifie cette économie de marché que l’on dit dominante, et disposons-nous des instruments nécessaires pour en comprendre les mécanismes. Non que de très nombreux ouvrages et articles n’aient fait progresser notre connaissance sur ce point, ne serait-ce qu’en introduisant une vision plus complexe des réalités comme des processus. Mais, l’effondrement du système soviétique du début des années quatre-vingt-dix, annoncé lui même par la stagnation de la fin des années soixante-dix, transforme la perspective. Il est important, et on défend ici même nécessaire, de procéder à la lecture de nos propres économies à partir de l’expérience des systèmes de type soviétique, et de leur difficile transformation. L’une des raisons, et ce paradoxe sert de colonne vertébrale à ce livre, est que le principal corps théorique utilisé pour comprendre nos économies, la Théorie de l’Équilibre Général, héritée de la modernisation apportée par Kenneth Arrow[3] et Richard Debreu[4] à la théorie de Léon Walras, suppose des hypothèses de départ qui, si elles étaient vérifiées, auraient dû conduire au succès de la planification centralisée[5].
La notion d’économie décentralisée
C’est évidemment à dessein que l’on utilise ici la notion d’économie décentralisée et non d’économie de marché ou d’économie capitaliste, afin de bien expliciter le refus du cadre de l’équilibre général[6]. Outre son caractère implicitement normatif, le terme d’économie de marché est trompeur d’un point de vue descriptif quand on l’applique aux économies occidentales. Ces dernières ne sont pas régies, ni principalement, ni de manière dominante par une logique de marché mais par des combinaisons, historiquement et géographiquement variables, de marchés et d’organisations, ainsi que par des fonctionnement qui font tout autant appel à l’itération marchande qu’au réseau ou au commandement. Fondamentalement, la notion d’économie de marché fait l’impasse sur l’entreprise, excusez du peu…
Les arguments les plus forts en faveur de la notion d’économie décentralisée sont ceux qui renvoient à son imprécision. Cette notion ne dit rien quant à la nature de la population d’agents qui la compose; elle est muette sur les formes de propriété. Cette imprécision est ici un gage de généralité. En fait, cette notion n’insiste que sur un point, mais fondamental, c’est l’absence de solution ex-ante au problème de la coordination. Soutenir que l’économie est d’abord décentralisée revient à poser le problème de la globalisation des actions et des effets de ces dernières comme objet principal des recherches. Comment cette globalisation peut-elle se mettre en oeuvre, à quelles conditions se déroule-t-elle de manière efficace, voilà tout autant de questions qui surgissent une fois admis le postulat de la décentralisation.
Cependant, si l’imprécision de cette notion est attractive, elle alimente aussi les critiques de certains détracteurs qui vont lui reprocher une indétermination préjudiciable à l’analyse.
La notion d’économie capitaliste, qui est alors préférée pour de multiples raisons, soulève quant à elle un problème plus subtil. Si on l’utilise en opposition aux anciennes économies de type soviétique qualifiées alors de socialistes, la question du critère de désignation doit être tranchée. On peut adopter celui de la forme de propriété[7], et considérer comme socialiste, ou plus exactement non-capitaliste, une économie où la propriété d’État est majoritaire. Pour simple qu’il soit, ce critère soulève cependant de très nombreux problèmes. En premier lieu il n’est pas sur qu’il soit discriminant dans le cadre de la théorie néoclassique. Dans la mesure où l’on admet l’hypothèse essentielle à cette dernière d’une perfection et d’une complétude des marchés, rien n’interdit de retrouver le mécanisme de l’équilibre général dans une économie où l’État serait le propriétaire unique et louerait le capital à des gérants. La question des droits de propriété ne devient pertinente que si on admet que les marchés ne sont pas parfaits et ne révèlent pas la totalité des informations.
Si l’on se situe dans un cadre marxiste, le critère de la propriété d’État pour définir le socialisme est en réalité contradictoire par exemple à un certain nombre d’écrits des “pères fondateurs”[8]. De plus, on est alors confronté lors des évolutions qui historiquement se sont déroulées au sein même de ces économies à de délicats problèmes de seuil, qui aboutissent à des résultats absurdes (économie capitaliste tant que l’on reste sous un seuil de 49,9% de propriété étatique, socialiste si on dépasse les 50%). Si on fétichise certaines situations des économies réputées capitalistes (un fort taux de chômage, des ajustements censés se produire par les prix, une finance libéralisée), au mieux on construit un modèle d’économie capitaliste qui ne s’applique qu’à très peu de pays, au pire on s’aveugle complètement sur les fonctionnements réels des économies réellement existantes, occidentales ou de type soviétique[9]. Les hypothèses normatives adoptées dans ce type de démarche ont un coût exorbitant en terme d’intelligence des économies réelles[10]. On découvre ainsi rapidement que les désignations et le vocabulaire recouvrent des débats centraux.
Cependant, la notion d’économie décentralisée pourrait prêter le flanc à deux critiques. La première consiste à remarquer que, par ce terme, on assume une filiation avec l’œuvre de F.A. Hayek, et en général avec une partie de l’école autrichienne. En particulier, cela peut signifier que l’on fait de la coordination le problème central dans les sciences sociales[11]. La seconde tient dans l’oubli que cette notion semble introduire de la spécificité du problème de la propriété qui donne à l’économie capitaliste sa particularité dans les systèmes marchands. Après tout, Marx ne fut pas le seul à insister sur la notion de capitalisme, un terme largement employé par Schumpeter. On peut craindre alors soit une euphémisation (le terme d’économie décentralisée semblant plus neutre) soit un refus de reconnaître une spécificité importante. Ajoutons encore que si, comme c’est ici le cas, on récuse les bases de la théorie néoclassique, alors la question de la propriété devrait être centrale[12].
Pertinence du problème de la coordination
Il peut en effet sembler étrange pour qui s’affirme comme un critique du libéralisme moderne, de se réfèrer à l’oeuvre de celui qui, pour le meilleur et pour le pire, en passe pour l’un des fondateurs. Il faut cependant ici préciser trois points. Tout d’abord, Hayek n’a pas la l’exclusivité d’une attention donnée au problème de la coordination. Ceci se trouve tant chez Adam Smith que chez Marx. Ce dernier développe et transforme la thèse de Smith sur la division du travail, en montrant la distinction fondamentale entre division manufacturière et division sociale[13]. Quels que soient les doutes que l’on peut avoir sur la validité de la réponse de Marx au problème de la coordination[14], on ne saurait prétendre qu’il n’a pas fait de cette question un point central de sa démarche. Il semble donc parfaitement légitime de faire de la décentralisation, la condition qui constitue la coordination en problème à résoudre et non en donnée de départ, la base du raisonnement.
A cet égard, il faut ici ajouter que la notion de décentralisation, envisagée comme la résultante d’une division du travail sans cesse approfondie conduisant à une spécialisation des activités et des acteurs et de l’absence d’une organisation à-priori des effets des décisions, peut constituer un critère opératoire pour envisager l’évolution des sociétés. Ainsi, il serait facile de repérer, dès la plus haute antiquité, des processus de division du travail. Pour autant, il est discutable que l’on soit dans une économie décentralisée, dans la mesure où cette division se déroulait dans le cadre de structures sociales intégrées, le manoir, la maisonnée, le palais, qui étaient pratiquement auto-suffisantes. La faiblesse des échanges entre ces structures réduisait alors les conséquences d’un manque de coordination. L’aléa y était fondamentalement non économique, prenant la forme de l’aléa climatique, de la guerre, de l’épidémie. A partir du moment où les structures intégrées s’ouvrent aux échanges, et deviennent par là dépendantes, il devient rapidement impossible d’exercer un contrôle à-priori sur les effets de la division des tâches. La coordination devient à la fois nécessaire et possible uniquement comme constat ex-post. Les sociétés doivent alors la constituer en problème à résoudre, en source potentielle d’un aléa supplémentaire. Les économies entrent alors dans des régimes d’opération qui sont radicalement différents des précédents, même si souvent la différence technique entre eux sont faibles.
Ensuite, il faut préciser que cette définition ne prétend nullement se situer au niveau du “capitalisme profond” mais à celui du “capitalisme manifeste” pour reprendre un vocabulaire emprunté à Marx, c’est à dire au niveau des formes de manifestation des activités économiques. En un sens, on peut considérer qu’il y a une critique implicite à la vision héritée de la tradition marxiste de l’économie de marché. Celle-ci est dans ce cadre caractérisée comme un monde d’anarchie, que l’on oppose alors à l’ordre technique de la fabrique. On soutient que cette vision contient deux erreurs. La première est de croire que l’ordre de la fabrique (dont il faut rappeler qu’il est despotique) se situe au même niveau de questions que la dite anarchie. Autrement dit, on conteste que le modèle de la fabrique soit extensible à la société. La seconde revient à ne pas voir les différences de degré et de nature dans l’anarchie de l’économie de marché. Que cette dernière puisse aboutir à des désordres insupportables, à des crises et des gaspillages qui sont socialement intolérables, est hors de doute. Mais, ces situations sont des moments temporaires et extrêmes, et non des états permanents. La polarité anarchie du marché/ordre de la fabrique masque l’existence de régimes de coordination plus ou moins stables et plus ou moins efficaces, qu’elle s’interdit d’analyser et par là de comprendre. Une telle attitude serait, à la limite, acceptable si on pouvait avoir l’assurance que l’économie décentralisée n’est qu’un court moment transitoire dans l’histoire de nos sociétés. Mais, si les prétentions à éterniser les systèmes sociaux existants, qui ont pris la forme de la ridicule formule de la “fin de l’Histoire”, ne témoignent que de l’ignorance de ceux qui les défendent, il est clair que l’économie décentralisée est appelée à être le cadre et le contexte de nos sociétés pour un temps non négligeable. Dans ce cas, les différences de succès dans les régimes de coordination deviennent un objet pertinent de recherche.
Propriété et densité
En fait, c’est l’opposition même entre une propriété individuelle, réputée essentielle à la définition des droits économiques et une propriété collective, supposée conduire à des formes d’indétermination, et par là d’inefficacité, qui a constitué en démarche propre la réflexion économique sur les droits de propriété[15]. La notion de propriété a d’ailleurs pris une importance d’autant plus grande que l’on remettait en cause les postulats traditionnels de l’économie néoclassique quant à la complétude et la perfection des marchés[16]. L’imperfection des marchés, et l’incomplétude des contrats pouvant y être passés, mettait au premier plan la question du contrôle sur les actifs physiques, et par là sur les travailleurs liés à ces actifs[17]. La propriété est alors définie par O. Hart et J. Moore comme la possibilité pour le propriétaire d’exclure quiconque de l’usage de ce bien suivant sa volonté[18]. Cette logique se situe expressément dans une contestation de certaines des hypothèses du marché traditionnel de la théorie néoclassique. Les imperfections du marché, ses échecs, sont ici structurels, et ce sont eux qui justifient l’importance accordée à la propriété. Ceci devrait induire quiconque entend développer une vision de l’économie explicitement critique de ces hypothèses à considérer avec bienveillance la théorie des “droits de propriété”. Pourtant, d’autres arguments sont de nature à faire penser qu’il s’agit en réalité d’une fausse piste.
On accepte ici l’idée que la propriété se définit, au-delà de la formule juridique classique du jus utendi et abutendi , par deux attributs essentiels que sont le contrôle et la responsabilité. Être tenu pour propriétaire de quelque chose signifie fondamentalement disposer d’un pouvoir résiduel de contrôle sur cette chose et pouvoir être tenu pour responsable des dommages non intentionnels causés par l’usage de cette chose. Ce problème serait sans importance si nous vivions tel Robinson sur une île déserte. Ce n’est pas le cas, et même fondamentalement, l’idée de la robinsonnade va à l’encontre de tout ce que l’on peut savoir sur les processus de développement de l’espèce humaine qui implique la vie en société. Il faut alors mettre au premier plan la question de la densité, non point dans sa définition démographique (encore que cette dernière ait une pertinence) mais dans une définition économique. Celle-ci peut s’exprimer de la manière suivante: est considérée comme dense toute société où l’action de l’un de ses membres est susceptible d’entraîner un effet (positif ou négatif) non-intentionnel sur au moins un autre membre. Le degré de densité est ici fonction non seulement de la densité démographique, mais aussi de la capacité à agir des individus. Plus les moyens d’action sur la nature se développent et plus les effets non-intentionnels d’une action sont importants.
Cette notion de densité a des implications radicales sur la compréhension qu’il faut avoir du concept de propriété. En effet, si nous sommes dans une société dense au sens utilisé ci-dessus, c’est à dire dans une société où toute décision d’un agent (A) fondée sur le contrôle du bien (x) peut engendrer, outre un effet intentionnel, un effet non-intentionnel réputé dommageable sur l’agent (B), le jus utendi et abutendi de (A) sur (x) doit être limité. Il peut l’être par un accord bilatéral préalable entre les deux agents, par exemple l’accord pour ne pas faire de musique dans un appartement après une certaine heure. Mais, les accords bilatéraux sont par nature limités. D’une part, ils impliquent que l’on puisse déterminer qui sera touché par les effets non-intentionnels de l’action. Autrement dit, ces derniers doivent être prévisibles, ce qui est loin d’être toujours le cas. D’autre part, les accords bilatéraux engendrent toujours au bout du compte des querelles en interprétations, et donnent naissance à l’émergence de règles collectives pour limiter les effets de ces querelles, règlements de copropriété, réglementations municipales, législations nationales. Dans la mesure où la totalité des effets non-intentionnels ne peut être connue à l’avance autrement dit dans la mesure où nous reconnaissons notre incapacité à prévoir totalement l’avenir.
Ces réglementations doivent donc être ouvertes. Il est impossible de préciser à un moment donné que les réglementations ne seront jamais changées, dans la mesure où les effets qu’elles doivent prévenir ne sont pas donnés instantanément mais se révèlent au cours même du processus de l’action et de sa répétition dans le temps. Il est ainsi douteux qu’au temps des DeDion-Bouton on ait pu prévoir la pollution par l’ozone engendrée par la circulation automobile en zone urbaine. Mais, si les réglementations constituent un ensemble ouvert, le droit d’usage devient définit par défaut. Il s’ensuit alors que le droit résiduel de contrôle du propriétaire est toujours second, en logique, au contrôle collectif qui s’exerce par l’intermédiaire de ces règles collectives. On ne peut donc comprendre l’usage individuel d’un bien ou d’un service qu’à partir du postulat de l’existence de règles collectives qui limitent cet usage et attribuent à la collectivité une part de contrôle comme une part de responsabilité. En effet, dans la mesure où le propriétaire a respecté la réglementation existante, il ne peut être tenu pour responsable des effets non-intentionnels nouveaux qui pourraient se révéler avec le temps, et ce jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle réglementation. Cette dernière assume ainsi à la fois la forme d’une limitation de l’usage et d’une libération de ce dernier. Si, à l’inverse de ce raisonnement, nous étions dans une société non-dense, soit une société où l’agent (A) puisse être sur que l’usage qu’il fera de (x) n’engendrera aucun effet non-intentionnel sur qui que ce soit, on pourrait se passer de règles collectives. Mais, en vérité, on pourrait se passer de la notion même de responsabilité, et par là de celle de propriété. Il n’est donc de propriété individuelle que dans la mesure ou il est conjointement une propriété collective sur le même bien ou service.
La propriété est donc, par nécessité, duale. Il convient ici de ne pas confondre dualité et mixité. La notion de mixité renvoie au partage d’une structure de propriété entre des agents privés et la puissance publique. Ceci peut être, sous certaines conditions, une des formes de gestion de la dualité. Cette dernière exprime l’inévitable co-détermination de nos actions, à la fois individuelle et collective. Reconnaître la dualité implique alors d’abandonner l’image du propriétaire individuel Roi en son petit royaume, limité uniquement par les bornes de ses désirs, maître à bord absolu après Dieu, comme disent les marins.
Ceci est d’ailleurs parfaitement perçu par un auteur comme Richard Nelson, l’un des fondateurs de ce que l’on appelle l’école évolutionnaire, qui, dans un texte maintenant relativement ancien, a montré que le critère de la propriété privée ne pouvait servir de délimitation fondamentale dans l’analyse des systèmes économiques[19]. Il avance quant à lui deux arguments, d’une part l’imbrication permanente des formes privées et collectives de la propriété, et d’autre part l’incohérence des argumentaires tendant à faire de la propriété privée le critère discriminant. Le second argument soulève la question de la signification méthodologique de la cohérence interne d’un argumentaire.
Propriété ou stratégies d’appropriations?
La densification des sociétés modernes rend la dualité de plus en plus patente et tangible. Ceci provient, comme on l’a dit, à la fois de la croissance de la densité démographique à travers le phénomène historique de développement de civilisations urbaines, et du développement de nos moyens d’action sur la nature. La dualité irrémédiable de la propriété en fait de plus en plus une propriété qui est globalement sociale et il revient incontestablement à Marx d’avoir saisi cette montée de la dimension sociale dans la propriété, limitant toujours un peu plus la dimension individuelle. Cette dimension sociale est, pour lui, tout à la fois l’expression d’une dénaturation de la production marchande simple par la logique du capitalisme et une incapacité à faire fonctionner de manière purement individuelle ce qui est déjà en partie collectif[20]. Mais, cette compréhension du permanent mélange entre individuel et collectif ne donne pas lieu à une analyse spécifique, dans la mesure où il n’est vu que comme moment temporaire dans ucomplètement dupes des facilités qui sous tendent les glissements entre ces registres. Il n’y a pas de liens nécessaires unissant la description de ce qui est à celle de ce qui devrait être. De même, déterminer ce qui devrait être n’ouvre spontanément aucun droit à dire comment on pourrait y aboutir.
n processus devant conduire le capitalisme à se détruire. Ici, très concrètement, la dimension prophétique a bloqué la dimension analytique chez Marx. Ce qui l’intéresse dans la combinaison entre dimensions sociales et individuelles, c’est ce qu’il perçoit comme une contradiction de l’économie capitaliste. Cette dernière approfondit la propriété individuelle à un degré inouï, détruisant les formes traditionnelles de propriété sociale (que l’on se rappelle le passage dans Le Capital sur les enclosures en Grande Bretagne), mais pour, en fin de compte, donner naissance à une forme supérieure d’appropriation collective. On aura ici reconnu la figure de la négation de la négation, forme dialectique qui est au coeur de la dimension prophétique chez Marx. Elle est, à bien des égards insatisfaisante.
Il faut donc reprendre ici le chantier laissé ouvert par les prémisses de l’analyse de Marx, et ne pas retomber dans le fétichisme juridique d’une propriété purement individuelle, ce qui est le défaut des théoriciens des “droits de propriété”. Trois éléments sont donc à prendre en compte. D’une part, la propriété est tension (et non délimitation) entre de l’individuel et du collectif; d’autre part, la propriété est articulation entre contrôle et responsabilité; enfin, le phénomène de densification des sociétés qui va s’accroissant. Dans ces conditions, ce qui passe au premier plan pour une intelligence du système n’est autre que la notion dynamique de stratégie d’appropriation qui se substitue alors à la notion statique de propriété.
Une stratégie d’appropriation se caractérise par deux éléments: une tentative pour s’approprier l’utilité d’un bien ou d’un service et une tentative pour tenter de reporter la responsabilité des effets non-intentionnels de cette utilité sur autrui. Les stratégies d’appropriation, qu’elles soient individuelles ou collectives, sont toujours contradictoires à court ou à long terme. Elles engendrent des conflits dont émergent tout à la fois les formes temporaires et locales de l’équilibre entre l’individuel et le collectif, les formes juridiques du droit de propriété, enfin les formes du mouvement dans le temps et de ce point d’équilibre et des formes juridiques.
Partir de la notion de coordination, loin d’exclure la question de la propriété, en révèle au contraire la nature: celle de matérialisations temporaires et limitées d’institutions et de règles engendrées par les conflits entre stratégies d’appropriation. Ceci ne revient pas à dire qu’il faut oublier la question de la propriété, ou qu’il n’existe aucune différence entre des structures de propriété où celle-ci est réputée individuelle ou au contraire collective. Mais nous sommes alors dans une logique de la convention sociale, dont il faut alors analyser les conditions d’émergence et le rôle dans les comportements individuels et sociaux. De plus, ce qui importe en ce cas est moins la propriété au sens d’une absolutisation de l’opposition entre les catégories individuelle et collective, absolutisation qui révèle un idéalisme social, que les processus concrets d’appropriation. Un flux, un stock, une information, une connaissance, sont-ils appropriables, comment, par qui, et dans quelles conditions. Les conflits engendrés par l’incompatibilité des différentes stratégies d’appropriation recomposent en permanence les formes de manifestation de la propriété.
économie et formes de séparation sociale
Voila pourquoi on adopte, à la suite de Charles Bettelheim, l’idée qu’est capitaliste une économie connaissant la double séparation entre les moyens de production et les travailleurs et entre les producteurs[21]. La première fonde le salariat, et à partir de là des dynamiques propres tant au fonctionnement de cette organisation productive que l’on appelle l’entreprise ou la firme, mais aussi au modes de répartition de la richesse nationale. La seconde fonde la décentralisation radicale du système.
Ceci permet de comprendre la généralité de la question de la décentralisation, et donc l’importance de sa compréhension. On peut en effet supposer la suppression de la première séparation (le passage par exemple d’un système de salariat à un système généralisé de coopératives). En ce cas, on sortirait du cadre de l’économie capitaliste. Pour autant, on ne supprimerait pas la question de la décentralisation de l’économie. Partir donc de cette dernière notion, c’est à dire du couple indépendance de la décision des acteurs/interdépendance des effets de ces décisions sur les situations et les conditions des décisions suivantes, permet de penser un nombre considérable de systèmes économiques réels ou potentiels. Elle conduit à mettre, à la suite d’auteurs comme Keynes ou Shackle, au premier plan la question de l’incertitude radicale qui caractérise les processus de production, consommation et répartition qui sont dépendants de prévisions faites ex-ante par des acteurs individuels et des effets ex-post des décisions prises sur la base de ces prévisions.
Ceci permet de comprendre pourquoi on adopte en toute connaissance de cause une approche qui ne fait pas du critère de propriété la norme d’évaluation ou de compréhension des économies réelles. On soutient, ici, qu’il y a beaucoup d’idéologie, dans le plus mauvais sens du terme, dans les discours qui se concentrent sur la forme de la propriété, que ce soit pour réclamer de larges nationalisations, ou au contraire exiger d’amples privatisations. Ces discours ont souvent des fondements théoriques douteux[22]. On ne peut ainsi argumenter en faveur de la privatisation quand on se situe explicitement dans un cadre théorique de type néoclassique. Si les marchés étaient parfaitement efficients en matière de transmission des informations et d’engendrement des incitations des acteurs, ces marchés seraient à même de gérer les questions du contrôle et de la responsabilité par l’intermédiaire de contrats complets (au sens intégrant la totalité des possibilités possibles pour la durée du contrat). On mesure ainsi le comique involontaire des discours libéraux qui justifient les politiques de privatisation, en particulier dans les services publics, au nom de réformes structurelles censées nous conduire à des marchés efficients.
Si, maintenant, on a des doutes justifiés quant à l’efficience des marchés et la possibilité de contrats complets, alors ce qui importe n’est pas l’idéalisation d’une propriété individuelle totale, réalisable uniquement dans le cas de Robinson sur son île, mais la compréhension des tensions entre les dimensions individuelles et collectives du contrôle et de la responsabilité. C’est donc la question des stratégies d’appropriation qui devient centrale, et non celle des formes de la propriété. Or, ces stratégies d’appropriations sont formées par des agents qui, individus ou collectifs, sont séparés les uns des autres. On retrouve alors la question de la coordination, qui s’affirme bien comme l’enjeu analytique central dont il faut refuser de se laisser distraire. Les conditions de manifestation, de réussite, des stratégies d’appropriation engendrent d’ailleurs de nouvelles formes de séparation sociale qui s’ajoutent aux fondements que l’on a évoqués.
La double division sur laquelle se fonde l’analyse de C. Bettelheim, est ainsi analytiquement fondamentale. Il faut cependant comprendre qu’elle n’est pas (et ne s’est jamais prétendue) directement opératoire. Les sociétés qui se développent sur la base des économies décentralisées sont bien plus divisées, bien plus hétérogènes, et par là bien plus complexes, que ce que pourrait suggérer une analyse qui voudrait lire directement la réalité à partir de la double division. Une telle lecture est impossible, et correspond à la négation même de l’existence de différents niveaux d’analyse, du plus concret au plus abstrait. Cette négation s’enracine dans une longue tradition positiviste de l’économie standard.

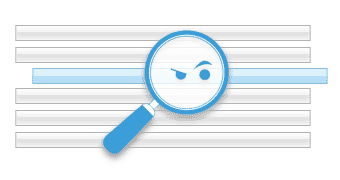





Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!